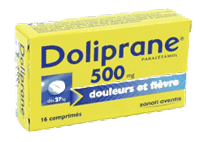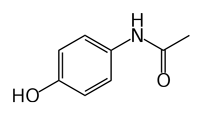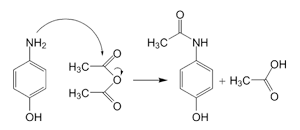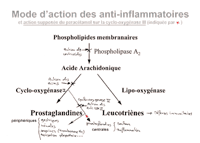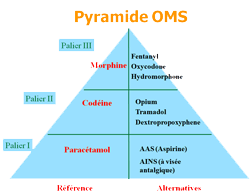IntroductionLe paracétamol, aussi appelé acétaminophène, est la substance active de nombreuses spécialités médicamenteuses de la classe des antalgiques antipyrétiques non salicylés. Il est indiqué dans le traitement symptomatique de la fièvre et des douleurs d'intensité faible à modérée, seul ou en association à d'autres analgésiques. Contrairement aux anti-inflammatoires non stéroïdiens et notamment à l'aspirine, il est dépourvu de propriétés anti-inflammatoires et n'agit pas sur l'agrégation plaquettaire. Le paracétamol est le médicament le plus prescrit en France — les trois médicaments les plus prescrits sont tous à base de paracétamol et totalisent plus de 260 millions de doses. 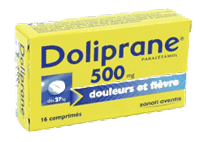 Il a l'avantage de présenter peu de contre-indications, de pouvoir être prescrit à tout âge et d'être dénué d'effets indésirables sérieux lorsqu'il est utilisé à la posologie recommandée. En cas de surdosage cependant, le paracétamol est très toxique pour le foie; il est chaque année responsable de décès. L'action analgésique et antipyrétique du paracétamol a été découverte à la fin du XIXe siècle. A cette époque, les antipyrétiques étaient fabriqués à partir d'éléments naturels tels que l'écorce du saule ou du quinquina (dont est extraite la quinine). Il a l'avantage de présenter peu de contre-indications, de pouvoir être prescrit à tout âge et d'être dénué d'effets indésirables sérieux lorsqu'il est utilisé à la posologie recommandée. En cas de surdosage cependant, le paracétamol est très toxique pour le foie; il est chaque année responsable de décès. L'action analgésique et antipyrétique du paracétamol a été découverte à la fin du XIXe siècle. A cette époque, les antipyrétiques étaient fabriqués à partir d'éléments naturels tels que l'écorce du saule ou du quinquina (dont est extraite la quinine).
Cette molécule plus que centenaire est née d'un heureux hasard. À la suite d'une erreur de liaison, deux médecins découvrent en 1886 les propriétés antipyrétiques de l'acétanilide. L'acétanilide est alors synthétisé à partir de l'aniline, molécule clé de l'industrie des colorants. Les dérivés de l'aniline déjà connus à l'époque, notamment la phénacétine, suscitent alors l'intérêt des médecins. En 1893, le médecin allemand J.von Mehring publie ainsi les résultats de ses études cliniques sur le paracétamol. Toutefois, ces dérivés de l'aniline en raison de leur toxicité sur l'hémoglobine, et bien que le paracétamol se montrât plus sûr, ne connurent pas le succès de l'aspirine. Rebondissement en 1948-49, lorsque les chercheurs américains B.Brodie, B.Flinn et E.Axelrod découvrent que l'acétanilide et la phénacétine sont dégradés par l'organisme en divers produits, dont le paracétamol. Ils démontrent ensuite que seul le paracétamol est la molécule active contre la douleur et la fièvre et que les autres produits de dégradation induisent les effets toxiques observés. Le paracétamol est introduit comme médicament dans la seconde moitié des années 50.
ProblématiquePourquoi le paracétamol est la molécule thérapeutique la plus vendue au monde ?
|
1) Chimiea- Composition et réactivitéDans les conditions ordinaires, le paracétamol est une poudre blanche avec un léger goût, soluble dans 70 volumes d'eau, 7 volumes d'alcool à 95%. Cependant, il est insoluble dans l'éther et le benzène. Le paracétamol est stable dans l'eau, mais sa stabilité diminue en milieu acide ou basique. Les mélanges de paracétamol sont stables dans des conditions humides. Cependant, les comprimés qui contiennent de la codéine ou du stéarat de magnésium se dégradent en diacétyl-p-aminophénol dans une atmosphère humide.
La molécule est constituée d'un cycle benzémique, substitué par un groupement hydroxyle et par un groupement amide en position para. Le paracétamol ne comporte pas de carbone asymétrique et n'a pas de stéréoisomère.
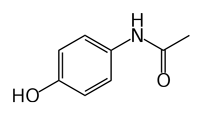 La présence de deux groupements activants rend le cycle hautement réactif pour une substitution électrophile aromatique, les substituants étant ortho- et para- directeurs. Toutes les positions du cycle sont plus ou moins activées de la même manière et il n'y a donc pas de site privilégié dans le cas d'une substitution électrophile. Le paracétamol est le métabolite actif de l'acétanilide et de la phenacétine: le paracétamol est produit par la decomposition de ces deux produits dans l'organisme. Ces espèces chimiques sont de la même famille chimique et ont une structure chimique très proche. La présence de deux groupements activants rend le cycle hautement réactif pour une substitution électrophile aromatique, les substituants étant ortho- et para- directeurs. Toutes les positions du cycle sont plus ou moins activées de la même manière et il n'y a donc pas de site privilégié dans le cas d'une substitution électrophile. Le paracétamol est le métabolite actif de l'acétanilide et de la phenacétine: le paracétamol est produit par la decomposition de ces deux produits dans l'organisme. Ces espèces chimiques sont de la même famille chimique et ont une structure chimique très proche.b- SynthèseLe paracétamol ne comprend pas de centre chiral et n'a aucun stéréoisomère. La synthèse n'a pas besoin d'être stéréocontrolée et est plus simple que les synthèses asymétriques d'autres substances pharmaceutiques. Le paracétamol fut synthétisé pour la première fois en 1878 par Harmon Northrop Morse. La première étape est la réduction du para-nitrophénol en para-aminophénol en présence d'étain dans de l'acide acétique glacial. Le produit obtenu est ensuite acylé par l'acide acétique pour obtenir du paracétamol.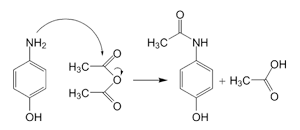 Vignolo simplifia cette synthèse en utilisant le para-aminophénol comme produit de départ. Une seule étape d'acylation est nécessaire pour obtenir le produit désiré, ce qui raccourcit la synthèse. Plus tard, Friedlander modifia la synthèse en faisant l'acylation du para-aminophénol à partir de para-nitrophénol avec de l'anhydride acétique au lieu de l'acide acétique, ce qui donne un meilleur rendement. Vignolo simplifia cette synthèse en utilisant le para-aminophénol comme produit de départ. Une seule étape d'acylation est nécessaire pour obtenir le produit désiré, ce qui raccourcit la synthèse. Plus tard, Friedlander modifia la synthèse en faisant l'acylation du para-aminophénol à partir de para-nitrophénol avec de l'anhydride acétique au lieu de l'acide acétique, ce qui donne un meilleur rendement.
Équation de la synthèse: C4H6O3 + C6H7NO → C8H9NO2 + CH3COOH
De nos jours, il existe différentes méthodes de synthèse industrielle, la plupart utilisant l'acylation du para-aminophénol avec de l'anhydride acétique.
En cliquant sur le lien suivant http://www.chimix.com/an6/sup/atl51d.htm s'ouvre le protocole des expériences que nous avions prévu de réaliser pour effectuer la synthèse du paracétamol. Nous aurions voulu rajouter ici nos vidéos ou photos et notre propre suivi de ces expériences, mais, alors même que nous nous apprêtions à les réaliser, nos encadrants nous ont demandé d'y renoncer du fait de la possible toxicité des éléments chimiques utilisés et produits, et du fait également que des terminales qui s'y étaient déjà essayés sans y parvenir...
|
2) Indication Le paracétamol est utilisé pour:
-Le traitement symptomatique des douleurs aiguës ou chroniques, d'intensité légère à modérée. Il s’agit d’un antalgique de palier 1 selon la classification de l’OMS. Il peut être utilisé seul ou en association avec d'autres antalgiques (codéine, dextropropoxyphène, tramadol), il rentre alors dans la classification des antalgiques de palier 2 indiqués dans les douleurs d’intensité modérée à intense.
-Le traitement symptomatique de la fièvre, en particulier chez l'enfant chez qui il constitue l'antipyrétique de première intention.
La dose ou posologie maximale peut varier d'un pays à l'autre selon la recommandation des produits de santé. En France, la recommandation est de:
-Adultes: 500 à 1000mg par prise, en espaçant les prises de 4 heures minimum. Il n'est généralement pas nécessaire de dépasser la dose de 3g par jour mais exceptionnellement (en cas de douleurs intenses non complètement contrôlées par 3g par jour, et sur avis médical), on peut atteindre un maximum de 4g par jour.
-Enfants: La dose quotidienne recommandée est de 60mg/kg/jour, à répartir en 4 ou 6 prises, soit environ 15mg/kg toutes les 6 heures ou 10mg/kg toutes les 4 heures. La dose maximale est de 80mg/kg/jour chez l'enfant de moins de 38kg selon les recommandations officielles en France.
|
3) Mécanisme d'action et devenir dans l'organismea- Mécanisme d'actionUn siècle après sa découverte, le mécanisme d'action du paracétamol n'est à ce jour pourtant pas connu de manière certaine, mis à part le fait qu'il agit principalement au niveau du système nerveux central, il existe plusieurs théories :
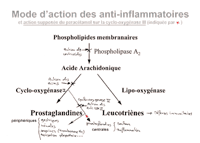 -Il inhiberait la production de prostaglandines, impliquées dans les processus de la douleur et de la fièvre, par le biais d'une action inhibitrice sur l'enzyme prostaglandine H2 synthase (PGHS), qui comporte notamment un site actif cyclo-oxygénase (ou COX), cible de la majorité des AINS, et un site « peroxydase » (ou POX), sur lequel agirait le paracétamol. Le paracétamol n'aurait pas d'action directe sur le COX-1 et le COX-2, les deux formes de COX sur lesquelles agissent les AINS comme l'aspirine ou l'ibuprofène. On soupçonne l'existence d'une nouvelle isoenzyme, le COX-3, sur laquelle agirait spécifiquement le paracétamol et qui expliquerait pourquoi le paracétamol réduit la fièvre et la douleur tout en étant dénué d'activité anti-inflammatoire et antiplaquettaire. (Mais pour l'instant, cette hypothèse n'a pas été prouvée chez l'homme). -Il inhiberait la production de prostaglandines, impliquées dans les processus de la douleur et de la fièvre, par le biais d'une action inhibitrice sur l'enzyme prostaglandine H2 synthase (PGHS), qui comporte notamment un site actif cyclo-oxygénase (ou COX), cible de la majorité des AINS, et un site « peroxydase » (ou POX), sur lequel agirait le paracétamol. Le paracétamol n'aurait pas d'action directe sur le COX-1 et le COX-2, les deux formes de COX sur lesquelles agissent les AINS comme l'aspirine ou l'ibuprofène. On soupçonne l'existence d'une nouvelle isoenzyme, le COX-3, sur laquelle agirait spécifiquement le paracétamol et qui expliquerait pourquoi le paracétamol réduit la fièvre et la douleur tout en étant dénué d'activité anti-inflammatoire et antiplaquettaire. (Mais pour l'instant, cette hypothèse n'a pas été prouvée chez l'homme).
-Un mécanisme d'action sérotoninergique central est suspecté aussi depuis quelques temps et qui expliquerait ses effets analgésiques et antipyrétiques. Le paracétamol favoriserait le fonctionnement de neurones sérotoninergiques descendants exerçant au niveau spinal (de la moelle épinière) un contrôle inhibiteur sur les voies de la douleur.b- PharmacocinetiqueL'absorption du paracétamol par voie orale est complète et rapide : le maximum de concentration plasmatique est atteint entre 15 minutes pour les comprimés effervescents et 30 à 60 minutes pour les comprimés et poudre après ingestion. Le paracétamol se distribue rapidement dans tous les tissus. Les concentrations sont comparables dans le sang, la salive et le plasma. Le paracétamol est métabolisé (c'est-à-dire transformé) essentiellement au niveau du foie. Les deux voies métaboliques majeures sont la glycuroconjugaison et la sulfoconjugaison. Il existe une voie métabolique, moins importante, catalysée par le Cytochrome p450, qui aboutit à la formation d'un intermédiaire réactif toxique, la N-acétyl p-benzoquinone imine ou NAPQI. Généralement, il est rapidement éliminé par réaction avec le glutathion réduit puis évacué dans les urines après conjugaison à la cystéine et à l'acide mercaptopurique.
L'élimination du paracétamol est essentiellement urinaire : 90 % de la dose ingérée est éliminée par le rein en 24 heures, principalement sous forme glycuroconjuguée (60 à 80 %) et sulfoconjuguée (20 à 30 %) et moins de 5 % est éliminé sous forme de paracétamol. La demi-vie d'élimination est d'environ 2 heures.
|
4) Utilisation et dangera- Contre-indications et précautions d'emploiContre-indications absolues :- Hypersensibilité au paracétamol.
- Insuffisance hépatocellulaire sévère.
- La dose journalière efficace la plus faible doit être envisagée, sans excéder 60 mg/kg/jour (sans dépasser 3 g/jour) dans les situations suivantes :
- adultes de moins de 50 kg
- insuffisance hépatocellulaire légère à modérée
- alcoolisme chronique
- malnutrition chronique
- déshydratation
Il est important de respecter la posologie maximale prescrite car des dangers sont bien entendu encourus en cas de surdosage (toxicité hépatique potentielle, etc) voire même la mort.
Pour éviter un risque de surdosage accidentel, il faut vérifier l'absence de paracétamol (ou la quantité moindre) dans la composition d'autres médicaments pris de façon concomitante, le principal des surdosages est accidentel.
La dose totale de paracétamol ne doit pas dépasser 80 mg/kg/jour chez l’enfant de moins de 37 kg et 3 g par jour chez l’adulte et le grand enfant au-delà de 38 kg et chaque prise doit être espacée d'au moins 4heures.
Le paracétamol est autorisé en cas de grossesse et d'allaitement. Il ne provoque pas d'effets tératogènes ou fœtotoxiques durant la grossesse. Pendant la période d'allaitement, le paracétamol passe dans le lait maternel. Toutefois, les quantités excrétées dans la lactation sont inférieures à 2 % de la quantité ingérée et le paracétamol n'est donc pas contre-indiqué pendant la période d'allaitement. Toutefois, il pourrait exister une relation entre la prise de paracétamol pendant la grossesse et plus spécialement au cours du premier trimestre, et le risque pour les enfants de souffrir de problèmes respiratoires ou d'asthme avant l'âge de 7 ans.
Il n'y a aucune interaction médicamenteuse particulière, ou en tout cas risquée, répertoriée pour le paracétamol.
Attention cependant lors de contrôles car la prise de paracétamol peut fausser le dosage de l'acide urique sanguin par la méthode à l'acide phosphotungstique, ainsi que le dosage de la glycémie par la méthode à la glucose oxydase-peroxydase.
De même, il n'y a aucune interaction alimentaire rapportée pour le paracétamol.b- Effets indésirables et toxicité (sur l'homme et l'environnement)1. Le paracétamol est habituellement très bien toléré lorsqu'il est pris à des doses thérapeutiques. Des effets indésirables ont néanmoins été rapportés sans que l'imputabilité ait été établie la plupart du temps. Les principaux effets indésirables retrouvés sont :- Très rarement : éruption cutanée avec rash ou éruption urticarienne d'origine probablement allergique, thrombopénie et asthme.
- Controversé : hépatite aiguë cytolytique et insuffisance rénale chronique.
- De façon ponctuelle : hypotension, choc anaphylactique, purpura vasculaire, syndrome de Lyell et syndrome de Stevens-Johnson, ulcération rectale, agranulocytose, pancréatite aiguë généralement en association avec d'autres médicaments comme la codéine, hépatite chronique active, hépatite granulomateuse et rhabdomyolyse.
Une toxicité sur le foie à dose thérapeutique ne peut également être exclue chez certaines personnes à risques. Chez le très jeune enfant, l'administration de paracétamol pourrait augmenter le risque de survenue d'un asthme. Devant l'apparition d'un effet indésirable, il est nécessaire d'arrêter le médicament incriminé et de consulter son médecin.
 2. Le paracétamol est un toxique lésionnel qui agit avec retard sur son organe cible principal, le foie. Le risque essentiel d'une intoxication aiguë est la survenue d'une insuffisance hépatocellulaire aiguë par nécrose hépatique centro-lobulaire. Le décès est possible. La dose toxique du paracétamol est hautement variable selon les individus mais la dose toxique théorique est, pour une dose ingérée unique, supérieure à 125 mg/kg chez l'adulte et 100 mg/kg chez l'enfant. Administrées sur de longues périodes, les doses thérapeutiques se rapprochent des doses toxiques, de plus, le paracétamol est présent dans de nombreux médicaments, mélangé à d'autres molécules, ce qui augmente le risque de surdosage involontaire. La toxicité du paracétamol est majorée chez les sujets présentant une induction enzymatique (barbituriques, alcool) ou une déplétion chronique en glutathion (dénutrition, alcoolisme chronique). 2. Le paracétamol est un toxique lésionnel qui agit avec retard sur son organe cible principal, le foie. Le risque essentiel d'une intoxication aiguë est la survenue d'une insuffisance hépatocellulaire aiguë par nécrose hépatique centro-lobulaire. Le décès est possible. La dose toxique du paracétamol est hautement variable selon les individus mais la dose toxique théorique est, pour une dose ingérée unique, supérieure à 125 mg/kg chez l'adulte et 100 mg/kg chez l'enfant. Administrées sur de longues périodes, les doses thérapeutiques se rapprochent des doses toxiques, de plus, le paracétamol est présent dans de nombreux médicaments, mélangé à d'autres molécules, ce qui augmente le risque de surdosage involontaire. La toxicité du paracétamol est majorée chez les sujets présentant une induction enzymatique (barbituriques, alcool) ou une déplétion chronique en glutathion (dénutrition, alcoolisme chronique).
Physiopathologie de l’intoxication : Une des étapes de la métabolisation du paracétamol produit une molécule toxique, la N-acétyl p-benzoquinone imine (ou NAPQI), via les cytochromes P450. Ce métabolite peut provoquer la mort des cellules hépatiques. Il est éliminé, dans le foie, par une réaction avec le glutathion qui capte les radicaux. Aux doses thérapeutiques recommandées, la NAPQI est éliminée par l'organisme et ne représente pas un danger. Par contre, lorsque la dose de paracétamol est trop importante, la NAPQI est produite en grande quantité, les réserves de glutathion s'épuisent et le foie n'arrive plus à l'éliminer; il subira des dommages plus ou moins importants selon la quantité de paracétamol absorbée. Un risque accru de toxicité est provoqué par un manque de glutathion (malnutrition, anorexie, éventuellement maladies du foie) ou une formation accrue du métabolite toxique.
Symptômes de l’intoxication : la phase initiale de l'intoxication peut être totalement asymptomatique. Les symptômes éventuels sont banaux : nausées, vomissements, anorexie, douleurs abdominales. Il n'existe pas de corrélation entre la présence ou non de symptômes dans les premières heures et la gravité de l'intoxication. Des signes biologiques d'hépatite cytolytique peuvent apparaître à partir de la 12ème heure (augmentation des ASAT et ALAT). A partir du 3e jour, l'évolution peut se faire dans les formes graves vers l'insuffisance hépatocellulaire aiguë, le coma hépatique et parfois le décès.
3. La toxicité du paracetamol sur l'environement : d'après une étude, le paracétamol pourrait se transformer en produit toxique, lorsque les usines de traitement des eaux usées utilisent le procédé de javellisation. Le paracétamol se transformerait, sous l’action de l’ion hypochlorite ClO-, en N-acétyl-p-benzoquinone imine et en 1,4-benzoquinone. La première molécule est toxique pour le foie tandis que la seconde est suspectée d’être génotoxique et mutagène. Des études supplémentaires doivent être effectuées pour savoir quelle est la concentration de ces substances à la sortie des eaux usées et pour connaître la persistance de ces produits dans l’environnement.c- Prise en chargeDès que la dose toxique théorique est dépassée ou que la dose ingérée est inconnue, l’hospitalisation dans un service d'urgence doit être immédiate, pour dosage plasmatique du paracétamol et mise en route précoce du traitement.Le lavage gastrique n'est pas indiqué.
La prise en charge associe l'administration de charbon activé (qui réduit l'adsorption digestive du paracétamol et présente moins de risques que le lavage gastrique) au traitement antidotique par N-acétylcystéine orale ou injectable qui aide à reconstituer les réserves de glutathion.
Lorsque l'heure de l'ingestion est connue, la concentration plasmatique du paracétamol après la 4ème heure, placée sur le nomogramme spécifique, permet d'indiquer la poursuite ou l'arrêt du traitement antidotique. L'administration de N-acétylcystéine doit être la plus précoce possible, au mieux avant la 8ème heure après l'ingestion du paracétamol. Sinon, l'utilisation d'acétylcystéine par voie intraveineuse est efficace en combinaison avec du charbon activé.
|
5) Comparaison avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et notamment l'aspirineLe paracétamol, contrairement à l'aspirine, est dépourvu de propriétés anti-inflammatoires. Il ne fait pas partie de la classe des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), n'étant pas un bon inhibiteur des COX et notamment de la COX-2. Les AINS eux, ont en commun la propriété de pouvoir diminuer la production des prostanoïdes en inhibant l'activité des deux isoformes de cyclo-oxygénases (COX-1 et COX-2).
En ce qui concerne le traitement de la douleur, l'activité antalgique du paracétamol est comparable à celle de l'aspirine, pour des posologies identiques de 1 à 3 g/jour et pour des douleurs de causes diverses.
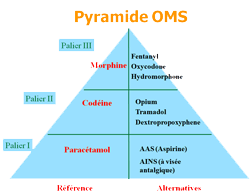 Des études renforcent la notion qu’il faut continuer à envisager le paracétamol comme traitement de première intention pour le soulagement de la douleur d’intensité légère à modérée d’après des évaluations effectuées relativement à l’innocuité, à l’efficacité et au coût. Le paracétamol a très peu d'effets secondaires. Les associations avec d'autres produits, plus puissantes ou mieux adaptées ne seront envisagées que dans un second temps, ou dans des cas spécifiques. Dans les doses recommandées, le paracétamol n'irrite pas la paroi de l'estomac, n'affecte pas la coagulation du sang autant que les AINS, et n'affecte pas le fonctionnement du rein. L’utilisation des AINS peut être à l’origine de cas d’hémorragies gastro-intestinales; le paracétamol, par contre, n’est pas associé à l’augmentation du risque d’épisodes gastro-intestinaux dans les doses normales. Cependant, certaines études ont montré que pour des doses élevées (plus de 2000 mg par jour) le risque de complications intestinales augmente.
Des études renforcent la notion qu’il faut continuer à envisager le paracétamol comme traitement de première intention pour le soulagement de la douleur d’intensité légère à modérée d’après des évaluations effectuées relativement à l’innocuité, à l’efficacité et au coût. Le paracétamol a très peu d'effets secondaires. Les associations avec d'autres produits, plus puissantes ou mieux adaptées ne seront envisagées que dans un second temps, ou dans des cas spécifiques. Dans les doses recommandées, le paracétamol n'irrite pas la paroi de l'estomac, n'affecte pas la coagulation du sang autant que les AINS, et n'affecte pas le fonctionnement du rein. L’utilisation des AINS peut être à l’origine de cas d’hémorragies gastro-intestinales; le paracétamol, par contre, n’est pas associé à l’augmentation du risque d’épisodes gastro-intestinaux dans les doses normales. Cependant, certaines études ont montré que pour des doses élevées (plus de 2000 mg par jour) le risque de complications intestinales augmente.
Le paracétamol ne présente pas de contre-indications pour les femmes enceintes et n'affecte pas le développement du fœtus comme le font les AINS (traitement de la persistance du canal artériel). L’utilisation des AINS par les femmes enceintes est associée, de façon importante, à l’hypertension pulmonaire persistante chez les nouveau-nés. Le paracétamol est actuellement très utilisé, notamment en pédiatrie. Il peut être administré aux enfants car il n'est pas associé au risque du syndrome de Reye pour les enfants possédant une déficience immunitaire. Une étude clinique faite chez des enfants montre qu'une dose standard d'ibuprofène provoque un plus grand soulagement de la douleur qu'une dose standard de paracétamol. Comme les AINS et contrairement aux opiacés, le paracétamol n'a pas été reconnu comme la cause d'euphories ou de modification d'humeur mais contrairement aux opiacés, il peut endommager le foie. Le paracétamol et les AINS présentent un faible risque d'assuétude ou d'addiction, contrairement aux opiacés.
En ce qui concerne le traitement de la fièvre, il ne semble pas exister de différence d'efficacité anti-pyrétique entre le paracétamol et les AINS. Concernant l'enfant, deux méta-analyses retrouvent que l'ibuprofène aurait une rapidité d'action légèrement supérieure au paracétamol. Mais c'est le paracétamol qui permettrait le mieux d'améliorer le confort de l'enfant, notamment au niveau de l'activité et de la vigilance. Au total on peut conclure que chez l'enfant, le paracétamol, l'ibuprofène et l'aspirine ont une efficacité anti-pyrétique identique mais que leurs effets indésirables sont sensiblement différents, ce qui finalement justifie amplement de privilégier le paracétamol en première intention.
|
Entretien avec un délégué médicalAfin d'étoffer nos recherches sur le paracétamol, nous avons établi un entretien avec Monsieur Jean de Labastie, délégué médical. Son métier est de promotionner les médicaments auprès des médecins et des hôpitaux. Il a travaillé pendant 20 ans pour les laboratoires UPSA et possède un diplôme DU de la prise en charge de la douleur.
Le but de cette rencontre était que monsieur Labastie nous apporte plus d’informations sur le paracétamol et qu’il nous aide à répondre parfaitement à notre problématique.
Comme il nous l’a précisé, le paracétamol porte 2 noms : Acétaminophéne et Paracétamol. C’est un antidouleur de palier 1 et il a un système d’action centrale (cerveaux, moelle épinière). Il est pourvu d’une très bonne tolérance. L’atout principal du paracétamol est d’avoir, à efficacité équivalente voire accrue contre les douleurs modérées et la fièvre, le moins d’effets secondaires par rapport à tous les analgésiques de palier 1.
Son utilisation est autorisée à toute personne aussi car il n’a aucune interaction médicamenteuse et possède une faible fixation sur les protéines plasmatiques (chargées de le transporter dans l’organisme). C’est pour cela que le paracétamol est la molécule la plus vendue au monde avec le meilleur rapport bénéfice/risque.
ConclusionLe paracétamol cumule une multitude de qualités pour très peu de points négatifs. Avant tout, il est plutôt aisé de le produire de manière industrielle à grande échelle de part la bonne connaissance de sa synthèse. Cette molécule, dont l’efficacité est prouvée, fait preuve d’une double action : antipyrétique et analgésique.
Contrairement à ses concurrents directs de palier 1, les AINS et l’aspirine, vite évincés, elle ne présente que très peu de contre-indications et d’effets secondaires indésirables, cela étant dû à l’action centrale uniquement sur les seules prostaglandines responsables de la douleur et de la fièvre. Elle ne présente pas non plus vraiment d’interaction médicamenteuse, est disponible en automédication, et les seuls quelques risques qui lui sont associés (principalement de hépatiques graves), ne sont encourus que par mauvaise utilisation de cette molécule (non respect de la posologie) ou automédication négligente (non surveillance des doses de paracétamol prises avec plusieurs médicaments différents pouvant amener à un surdosage involontaire).
La demande de paracétamol est bien sûr incessante, et en mai 2011 les ventes de doses de paracétamol étaient estimées à plusieurs centaines de milliards pour une industrie valant des billions de livres sterling par an. C’est ce qui fait de cette molécule, découverte par un hasard chanceux, la molécule thérapeutique la plus vendue au monde.
|
| |
| |
AnnexesNotice de l'Efferalgan
Notice du Nurofen
Notice de l'aspirine
Liste des médicaments contenant du paracétamol
RemerciementsUn grand merci aux deux enseignants qui nous ont encadrés tout au long de ce TPE :
M.CAZAMBO, professeur de Physique-Chimie et Mme.CHECCHI, professeur de SVT au Lycée Moulin Joli de La Possession.
Merci aussi beaucoup à M.Jean de LABASTIE qui a bien voulu partager ses connaissances et son expérience sur le sujet avec nous.
Merci également au père de Djodi pour son aide technique lors de l'élaboration de la page web. |
|
|
Sourceshttp://www.pharmacorama.com/ezine/Mode_d_action_du_paracetamol.php
http://www.biam.fr/substance/print/paracetamol.htm
http://www.cnrd.fr/Le-Paracetamol.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paracétamol |
| |